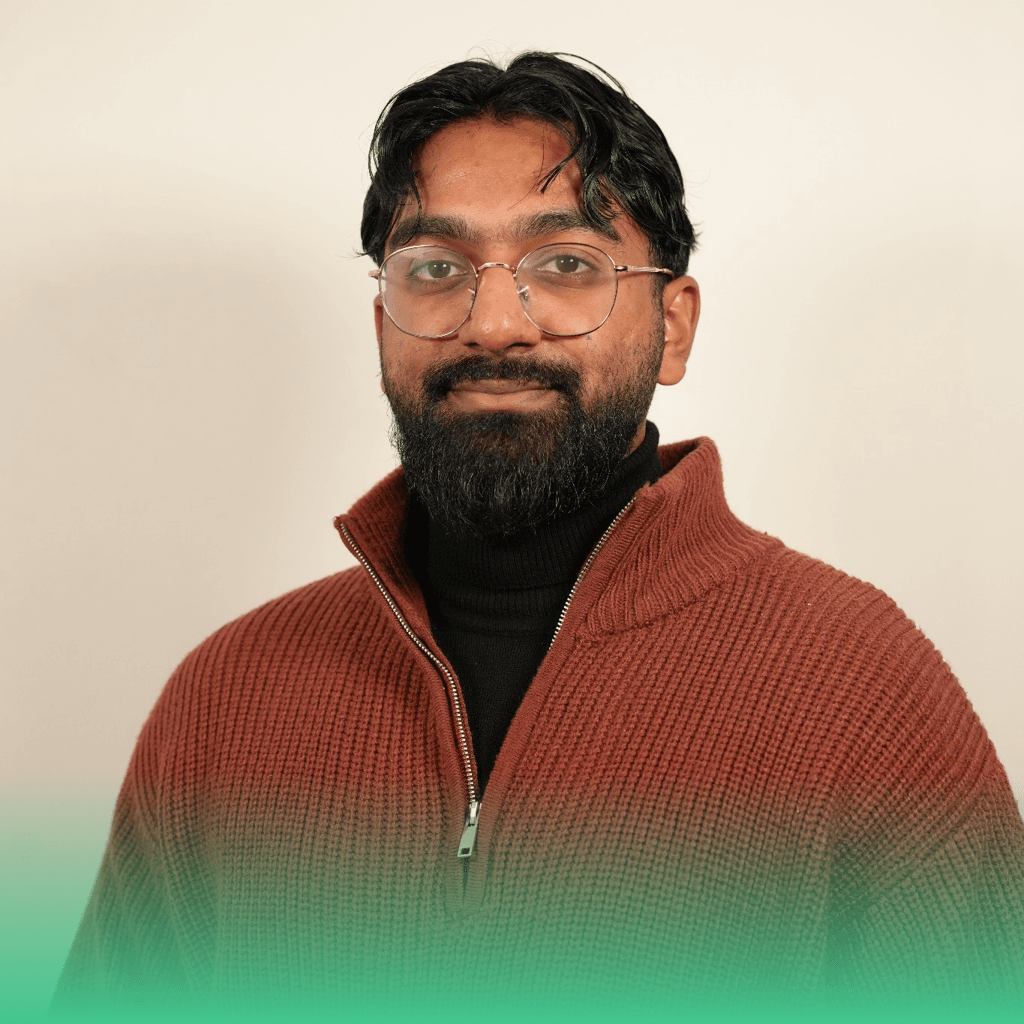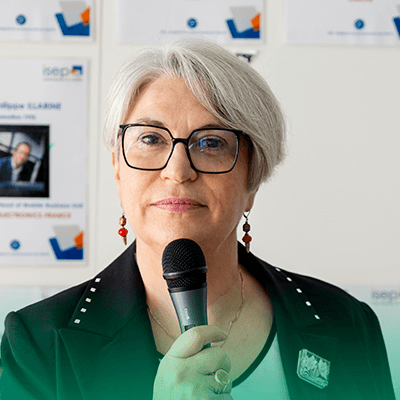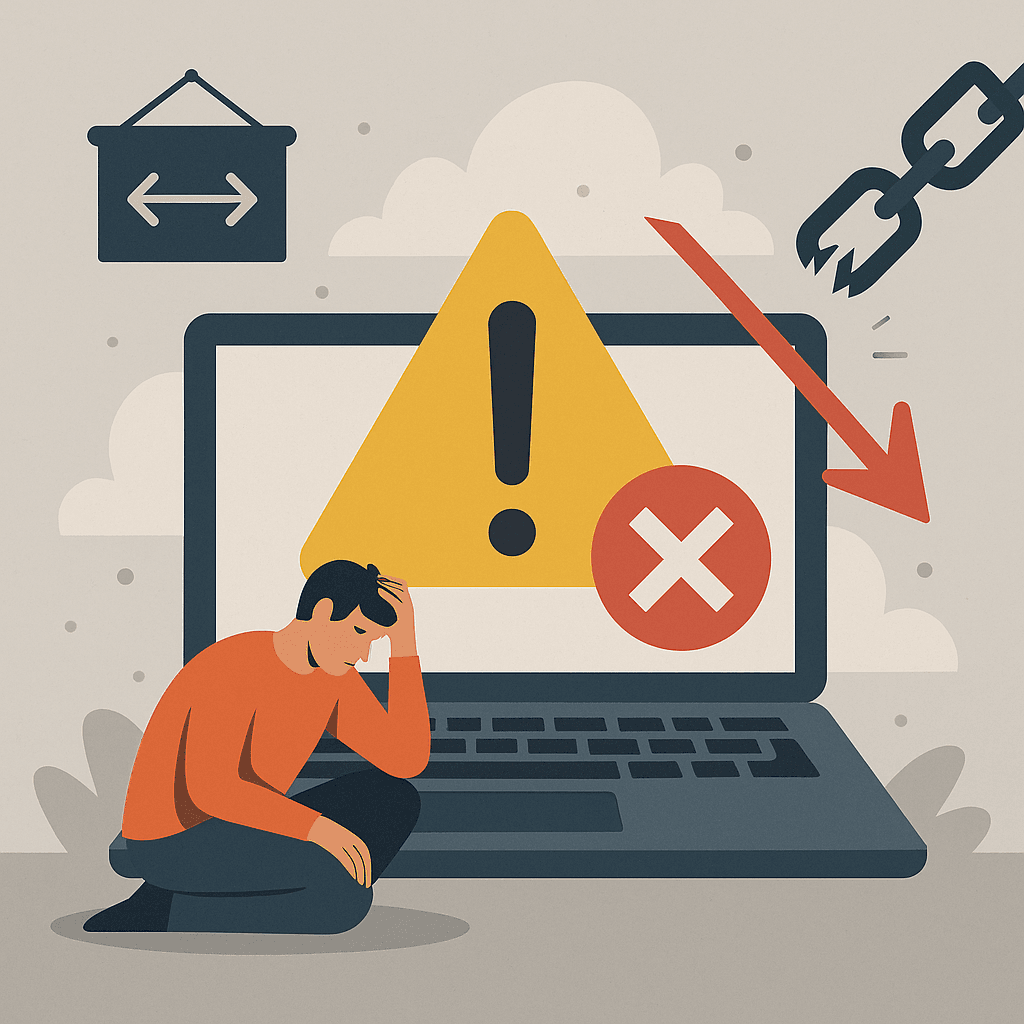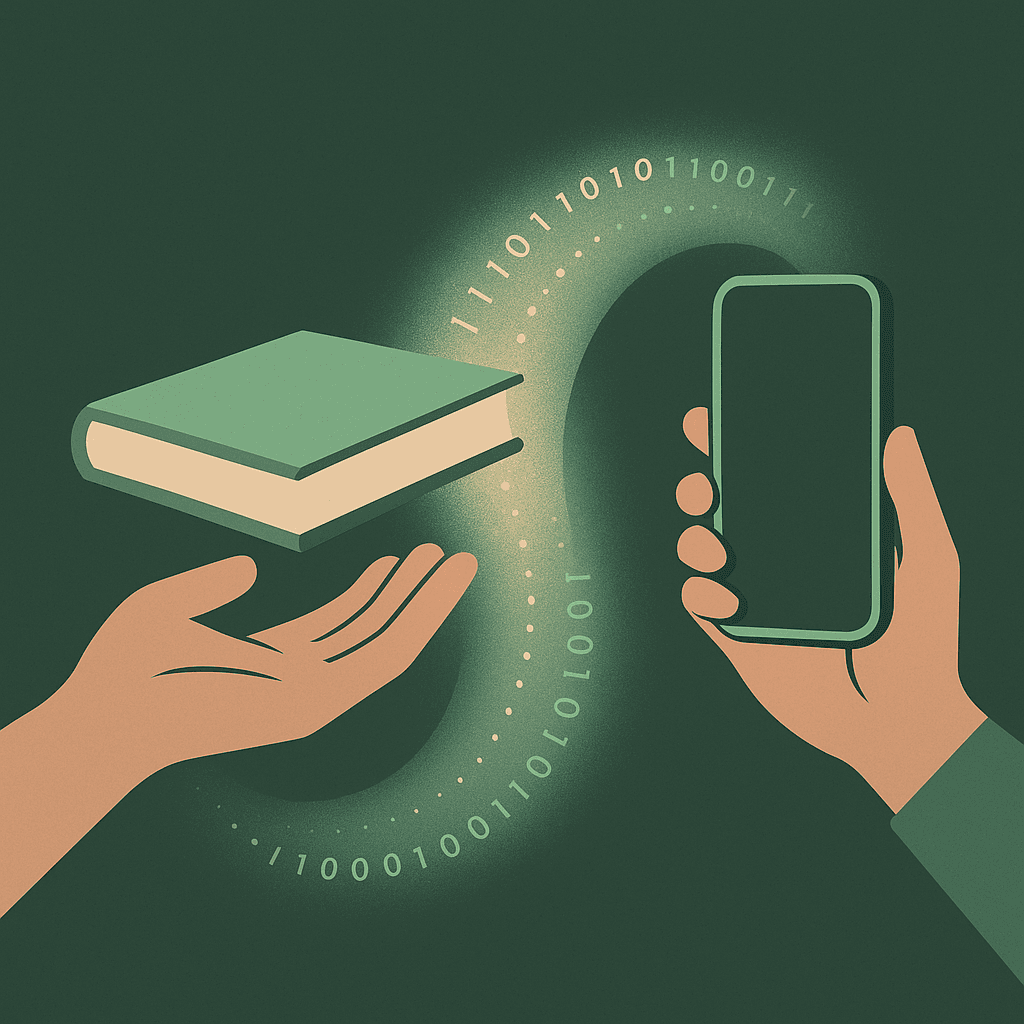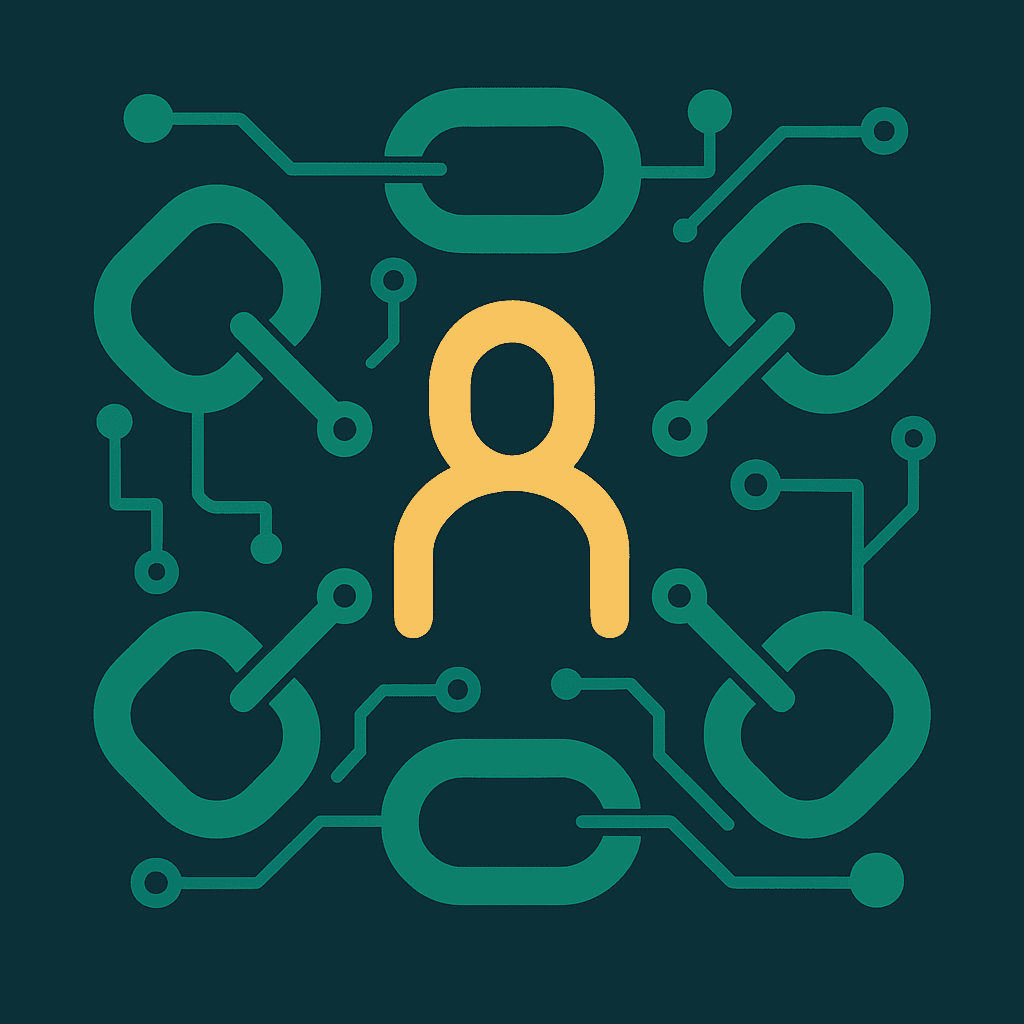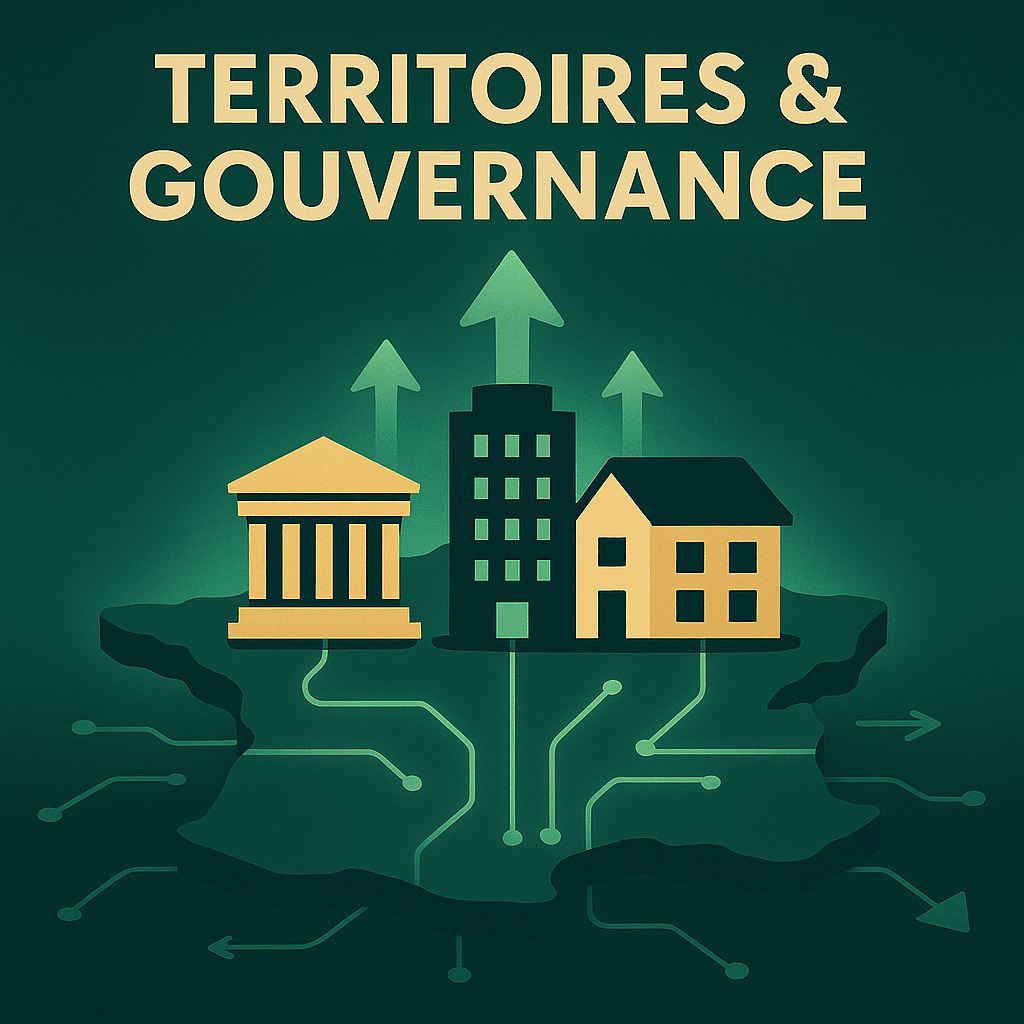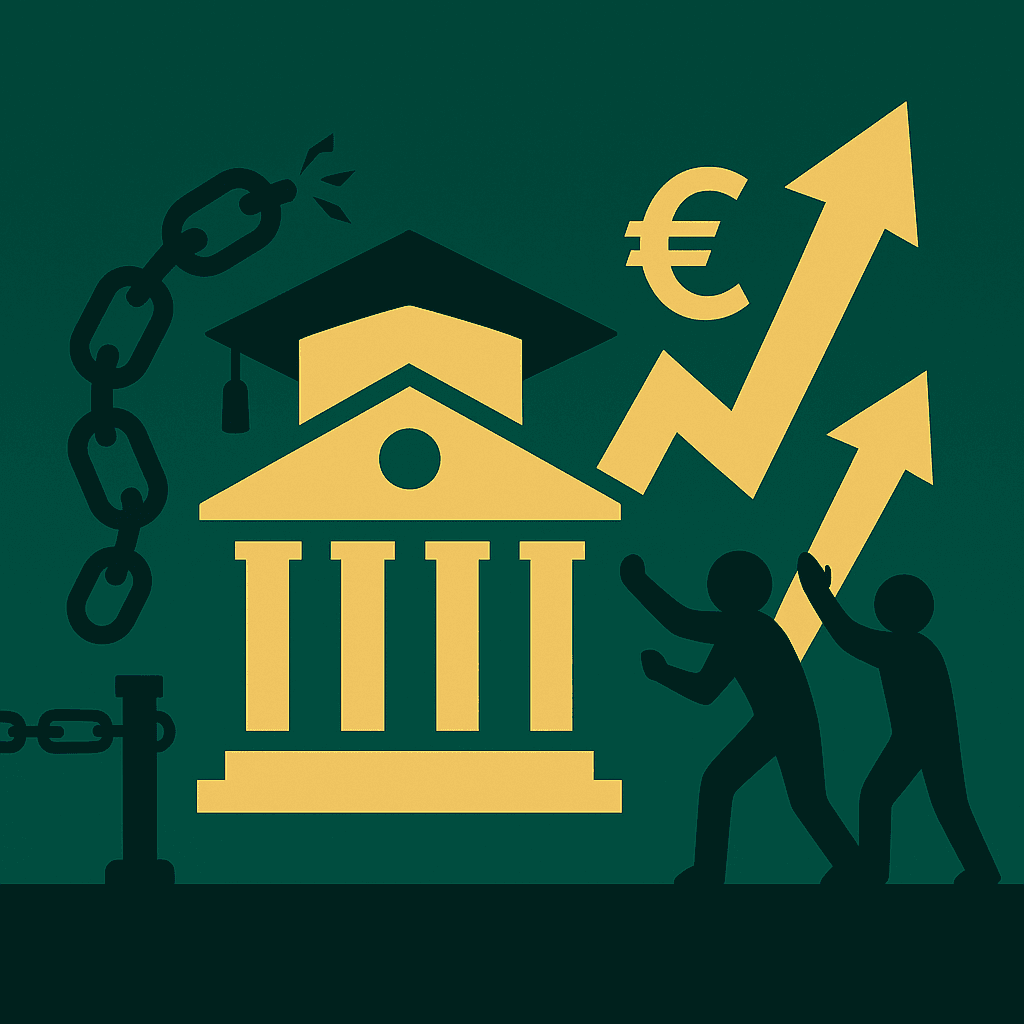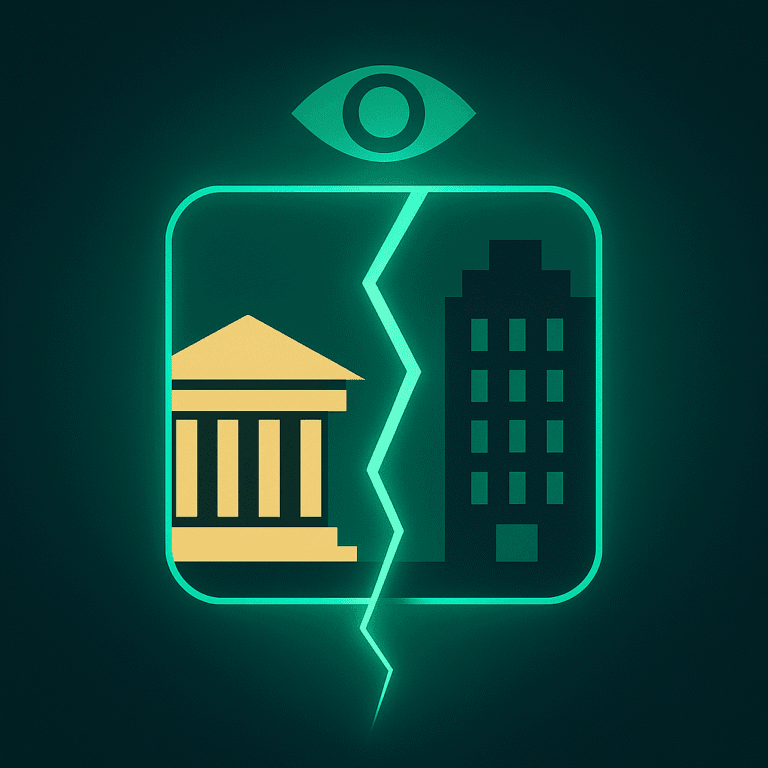
Le collectif EIES, composé majoritairement d’étudiants de grandes écoles, a mis en ligne près de 8 000 données provenant de 150 établissements, dont une trentaine de grandes écoles prestigieuses (CentraleSupélec, AgroParisTech, Sciences Po, Polytechnique, Paris-Dauphine, etc.). Cette cartographie révèle l’ampleur des liens tissés avec les géants de l’économie française – EDF, Safran, TotalEnergies, BNP Paribas, L’Oréal ou Dassault – via conseils d’administration, mécénat, chaires de recherche, bourses, financement de bâtiments ou visibilité sur les campus.
L’EIES pointe un « monopole » : les vingt entreprises les plus présentes interviennent dans plus d’un établissement sur deux, en moyenne 65 fois par an. Les secteurs dominants sont aussi ceux les plus contestés sur le plan social et environnemental (armement, énergies fossiles, industrie lourde).
La légitimation par la proximité
Les partenariats ne se limitent pas à l’argent. Ils donnent lieu à une présence symbolique : conférences, forums de recrutement, parrainages de promotions, construction d’amphithéâtres ou de résidences portant le nom des financeurs. Pour EIES, cette proximité vise à « fabriquer des idées », à légitimer des modèles économiques contestés et à tempérer les voix critiques. Les écoles, de leur côté, assument en partie ces choix : Sciences Po, par exemple, affirme que ses partenaires « rendent service aux étudiants » en facilitant leur insertion professionnelle, tout en refusant de rendre publics les montants investis.
Polytechnique, un cas emblématique
Polytechnique concentre les controverses. L’Observatoire des multinationales estime que l’école vit désormais à 15 % de financements privés, via sa fondation, soit vingt fois plus qu’il y a quinze ans. TotalEnergies, Uber ou le groupe marocain OCP financent des chaires ; une trentaine d’entreprises paient chacune 30 000 € par an pour une visibilité auprès des élèves. Des projets immobiliers (centre R&D de TotalEnergies en 2019, centre de recherche de LVMH en 2022) ont toutefois été abandonnés sous la pression d’étudiants et enseignants.
L’association Acadamia mène parallèlement une bataille juridique pour obtenir communication des conventions de mécénat. Polytechnique refuse, invoquant le « secret des affaires ». Le Conseil d’État doit trancher, dans une décision qualifiée de « charnière » par le président d’Acadamia, Matthieu Lequesne.
Une opacité qui nourrit la défiance
Au-delà des cas particuliers, c’est bien la transparence qui est en jeu. Les financements transitent souvent par des fondations adossées aux écoles, qualifiées de « boîtes noires » par les critiques. Or, ces structures bénéficient de dons défiscalisés tout en étant au service d’institutions investies d’une mission de service public.
Diagnostic rapide — Organisation & Systèmes
En 5 étapes, aidez-nous à comprendre votre contexte pour vous proposer un plan d’action adapté.
Temps estimé : 3–4 minutes. Vous pouvez interrompre à tout moment.
En envoyant, vous acceptez d’être recontacté par Seira au sujet de ce diagnostic.
Merci, bien reçu
Vos réponses ont été enregistrées. Nous revenons vers vous rapidement avec une proposition adaptée.
Pour des chercheurs comme Odin Marc (CNRS, Scientifiques en rébellion), la cartographie de l’EIES est une avancée précieuse : elle documente la manière dont les industries fossiles et d’autres secteurs controversés s’ancrent dans la production du savoir, influençant à la fois les recherches menées, les réseaux professionnels et l’imaginaire des futurs diplômés.
Enjeu : la fabrique des futurs possibles
L’article interroge en filigrane une question fondamentale : qui oriente l’enseignement supérieur et la recherche ? Si les grandes écoles acceptent des financements privés sans transparence, elles risquent de verrouiller le débat académique et de figer les orientations technologiques et sociales. Le collectif étudiant formule une crainte nette : tant que des « modèles économiques obsolètes ou dangereux » contrôleront à la fois les contenus et les structures de gouvernance, « aucune évolution radicale n’est possible ».
👉 Cet article souligne donc la valeur documentaire de l’initiative EIES et la portée symbolique du bras de fer autour de Polytechnique. Il met en relief la tension entre deux impératifs : l’ouverture des grandes écoles aux réalités économiques, et la nécessité de préserver leur autonomie intellectuelle et leur responsabilité sociale.